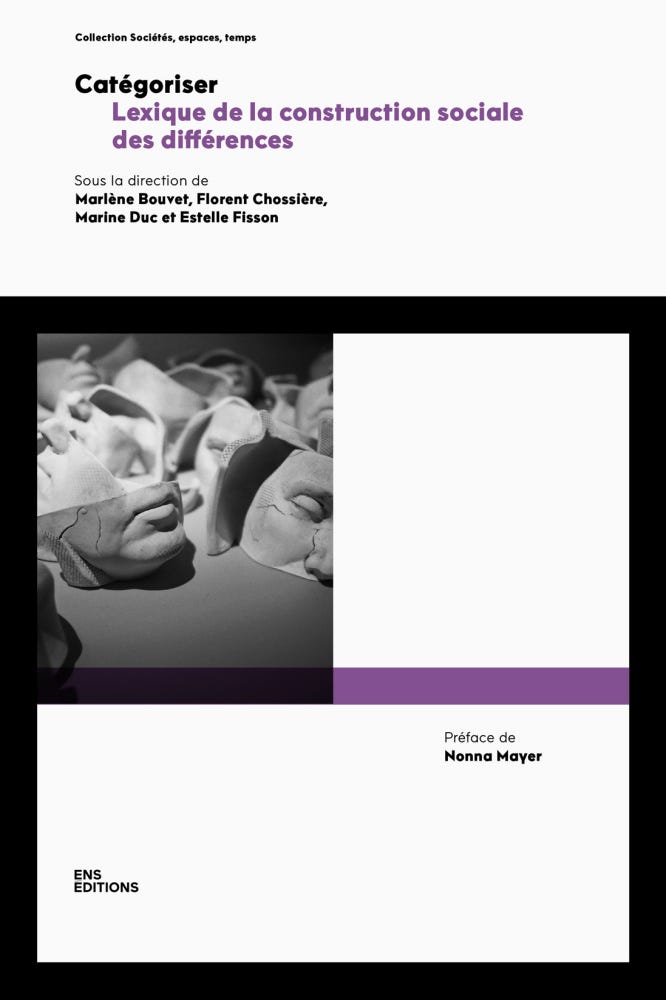#17 - faire front (populaire)
Le 24 mai, je publiais la 16e newsletter. Elle avait pour titre : “faire front”.
Moins de 3 semaines après, nous avions : le FN à 31,4%, la dissolution de l’Assemblée nationale et l’alliance des principales forces à gauches (Les Écologistes, LFI, NPA, PCF et PS) pour des législatives anticipées.
Moins d’un mois après, nous avions une vitrine de librairie jeunesse cassée, celle de la librairie Pantagruel dans le VIIe arrondissement de la ville de Marseille.
Juste derrière l’impact, Les Plus Beaux, album jeunesse publié aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Le premier album avec deux petits garçons amoureux, sans que ça soit un problème, un secret ou un ressort narratif.
Le premier et le seul.
En bas à gauche, L’amoureuse de Simone, publié aussi aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Le premier album avec deux petites filles amoureuses, sans que ça soit un problème, un secret ou un ressort narratif.
Le premier et le seul.
En bas à droite, les guides de la collection J’aimerais t’y voir, sur les enfants et leurs familles racisées, queers, qui questionnent et sortent des normes genrées.
Avec la montée de l’extrême droite, ce sont les attaques racistes, homophobes, transphobes, misogynes, validistes, xénophobes, islamophobes et antisémites qui explosent et continueront d’exploser.
Derrière l’impact, il y a nous, nos existences, nos récits, nos corps, nos enfants.
Plus que jamais, il est urgent de faire front (populaire) 🗳️
En librairie
Praline Gay-Para & Lauranne Quentric, Pomine & Pomette, Didier jeunesse.
Il s’agit d’un album avec une famille gayparentale, le 13e (yay). Comme la majorité d’entre eux (11), il s’agit d’expliquer qu’il est possible d’avoir deux papas. Dans celui-ci, on fait le récit de l’arrivée des enfants. Alors que Tom et Simon viennent d’emménager ensemble, ils partagent en deux une pomme d’amour. Ils mangent chacun leur moitié, puis jettent les trognons dans le jardin. Les deux morceaux tombent au pied d’un grand rosier aux fleurs rouges et roses. Des trognons pousse un pommier, qui finit par donner deux petites filles aux joues rondes, rouges et roses, comme des pommes. Les petites filles mettent à sac l’appartement, tombent et se mettent à pleurer. Les deux amoureux s’empressent alors de les consoler. Apaisées, elles s’endorment enfin. Au petit matin, alors qu’elles s’apprêtent à partir, les deux hommes les poursuivent : Restez ! Ne partez pas ! Vous serez nos filles et nous serons nos papas. Elles restent, ils les appellent Pomine et Pomette et tout va bien qui finit bien.
Depuis, Pomine et Pomette grandissent avec leurs deux papas, et leur bonheur durera tant que la lune existera. Et si vous ne me croyez pas, allez jeter un œil chez eux là-bas et vous verrez, l’amour ce n’est pas si compliqué que ça.
Plutôt que la graine du papa dans l’œuf de la maman, nous avons deux graines appartenant respectivement aux deux papas, jetées au pied d’un grand rosier. Cela pourrait correspondre à une insémination à partir des contributions des deux papas, sauf que cette insémination est toujours un choix, jamais un accident. Par ailleurs, cette insémination nécessite soit une mère porteuse (là où la GPA est légale), soit un ou plusieurs autre(s) parent(s).
C’est le cas des jumeaux Hic et Nunc, personnages des albums On n'est pas petits et Pareils et différents, publiés (encore une fois) aux éditions On ne compte pas pour du beurre. Les enfants vivent avec leurs deux papas mais ont aussi une maman. Il s’agit des seuls albums avec une famille gayparentale où la composition familiale est explicite sans être expliquée.
La représentation imagée de la gayparentalité dans Pomine & Pomette ne correspond à aucune réalité : il n’existe pas (encore) de moyens pour deux hommes cisgenres (à graine) de donner naissance sans l’avoir planifié et sans qu’une tierce personne ne soit impliquée. Cet album met en image le récit d’une parentalité gay sans dire, sans montrer, les parcours et réalités des familles gayparentales. L’amour ce n’est peut-être pas si compliqué que ça, mais écrire comment faire famille autrement peut l’être. Il ne suffit pas de reprendre les analogies héténormées en changeant les personnages.
Claire Garralon, Poussine, Talents Hauts.
Premier album pour les tout petits avec un personnage trans ! Est-ce que cette fois, on est content ?
Dans la section “T” de notre livre sur les représentations LGBTQI1+, Spencer Robinson commence par les albums ayant été identifiés comme ayant un personnage trans, possiblement à tort. On y retrouve des personnages questionnant leur identité de genre sans pour autant la remettre en question. “Suis-je une fille alors même que je suis une brute épaisse ? Oui, en fait.” plutôt que “Ne serais-je pas un garçon ? Je pense bien que oui…”. On y retrouve également des créatures merveilleuses pour qui il est habituel de changer d’identité de genre (Claude Ponti, Le fleuve, l’école des loisirs, 2018) et des personnages d’animaux cherchant à changer d’espèce (Alex Cousseau & Charles Dutertre, Le chat qui est chien, Rouergue, 2016). A propos de ces deux derniers cas, Spencer Robinson écrit :
Bien que nous ayons dans cet album des personnages qui transitionnent, cela se fait dans un monde aux règles si éloignées des nôtres que cela ne se rapproche en rien des expériences réelles des personnes trans humaines2.
Dans Poussine, nous avons un poussin qui demande à sa maman s’il sera une poule quand il sera grand. La maman lui répond qu’il ne sera pas une poule mais un poulet puis un coq. Alors qu’il a l’air désespéré, sa maman lui demande s’il ne veut pas être un coq. La conversation se poursuit comme suit :
- Non, je me sens poule, comme toi !
- Je ne sais pas si on peut être poule quand on naît coq, mon poussin.
- Mais moi je sais, maman !
Maman poule réfléchit.
- Moi aussi, je sais. Tu seras toi, mon poussin.
- Tu peux m’appeler Poussine maman ?
Nous n’avons donc pas un animal qui appartiendrait à une autre espèce, mais un poussin qui serait Poussine. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce qu’on utilise “poule” et “coq” d’abord pour désigner exclusivement les adultes, puis comme les catégories féminines et masculines tous âges confondus. Soit on naît poussin pour devenir poulet puis coq, soit on naît et reste coq. Soit on naît poussine pour devenir poule, soit on naît et reste poule3. Alors même que la maman (poule) parle bien de ce système comme d’un système stable, avec des règles et des normes stables qu’il faudrait en théorie suivre, les catégories utilisées dans le texte sont instables et incohérentes. Plus qu’un monde aux règles trop éloignées des nôtres, il s’agit d’un monde aux règles si instables et incohérentes qu’il est compliqué de lire ce dialogue comme celui d’un coming out trans. Comment faire comprendre ce que veut dire être un-e enfant trans si on transpose l’expérience dans une basse-cour, et si en plus les règles de cette basse-cour ne tiennent pas ?
Dans son guide4, Priscille Croce montre qu’il y a peu d’albums où les personnages mettent réellement et durablement les systèmes sexistes en péril. Il s’agit, pour la grande majorité, de victoires individuelles. Un petit garçon va réussir à avoir une poupée pour cette fois et pour lui-même seulement. Au début de l’album, les poupées sont considérées comme un jouet féminin. A la fin, elles le sont toujours. Ni le petit garçon en question, ni les petits garçons en général, ni les enfants en général, n’auront obtenu de libération durable : pouvoir jouer comme il leur plaît, sans injonctions normatives (genrées). Les rares albums où des personnages détruisent le système sexiste, en dehors des pépites d’Adela Turin et de quelques exceptions, ont pour personnage… des poules5. Comme l’utilisation de métaphores, faire appel à des personnages animaliers est un moyen de mettre à distance, d’euphémiser, des récits, des sujets, trop “sensibles”.
Trop “sensibles” pour qui ? On en revient donc au fil rouge de nos guides : pour qui publie-t-on ? Quel est le lectorat cible ? Quels enfants, et quelles familles, sont mis de côté ?
On explique avec distance et pudeur les vécus LGBTQI+ parce qu’on ne s’imagine pas qu’il puisse être possible de donner à voir un personnage LGBTQI+ sans explications. On ne s’imagine pas non plus qu’iels sont, elleux-aussi, des enfants lecteurices, des parents d’enfants lecteurices, des ami-es, des proches, des camarades, etc.
Pour plus de représentations LGBTQI+ humaines, explicites et banalisées, vous pouvez vous emparer de notre guide : Où sont les personnages LGBTQI+ en littérature jeunesse ?
On lit quoi ?
Ça y est, on l’a, l’ouvrage de référence sur les catégories sociales : Catégoriser. Lexique de la construction sociale des différences.
On écoute quoi ?
Question particulièrement actuelle : Peut-on aller bien dans un monde raciste ? C’est dans “encore heureux” avec Estelle Depris et Laura Nsafou ❤️
Découverts en formation doctorale (comme quoi, elles ne sont pas toutes complètement inutiles), les deux podcasts de la revue Contretemps : C’est quoi le plan ? et Contresons. Côté Contresons, on retrouve de l’analyse théorique, critique et politique (sociologie de la race, Gaza, islamophobie, luttes autochtones, etc.). Côté C’est quoi le plan ?, on explore des pistes pour un monde plus juste, rien que ça, (sécurité sociale de l’alimentation, la gauche face au capitalisme, l’union de la gauche, communisme et stratégie, etc).
Sur le carnet
Un an après l'interdiction de vente aux mineurs du roman érotique pour adolescent-es Bien trop petit, on se pose la question de l’érotisme en littérature jeunesse : Comment jouir en littérature jeunesse ?
Sur l’internet
Découverte de nouveaux carnets : INFO & CO, sur l’application des SIC en terrain scolaire, et IconoConte, sur l’iconographie des contes.
Sarah Ghelam & Spencer Robinson, Où sont les personnages LGBTQI+ en littérature jeunesse ?, J’aimerais t’y voir, On ne compte pas pour du beurre, 2024.
ibid., p.109.
Je suis à quatre jours d’être potentiellement remigrationnée et j’écris sur l’ordre social des gallinacées, tout va bien.
Priscille Croce, Où sont les albums jeunesse antisexistes ?, J’aimerais t’y voir, On ne compte pas pour du beurre, 2024.
Géraldine Collet & Maurèen Poignonec, Ma pauvre Lucette, Glénat, 2021.
Lena Landström & Olof Landström, Quatre poules et un coq, l'école des loisirs, 2005.
Adèle Tariel & Céline Riffard, La révolte des cocottes, Talents Hauts, 2011.