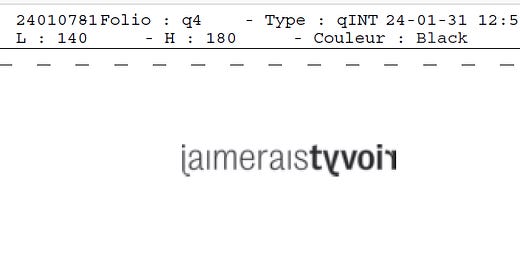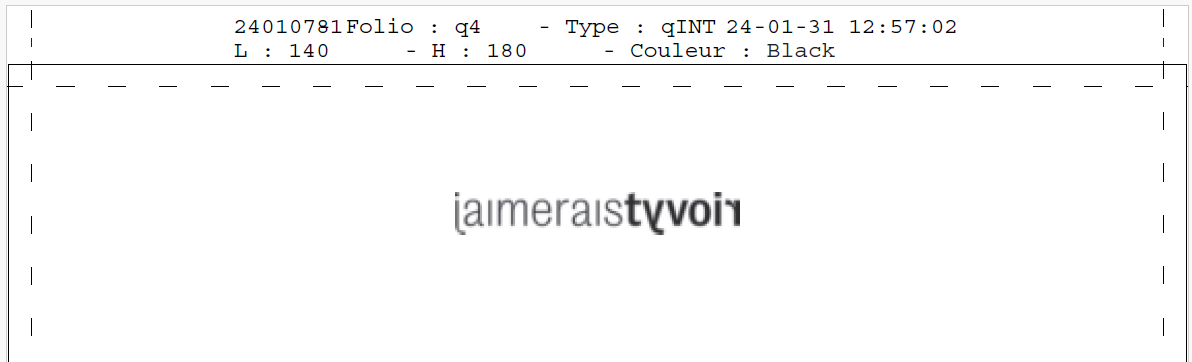#13 - Queeriser les panoramas de familles ?
Ça y est, les fichiers de la collection J’aimerais t’y voir sont partis à l’impression. Dans quelques jours, nous pourrons enfin avoir les livres de la collection entre nos mains !
Je ne manquerai pas de vous partager dans cette newsletter les différents événements prévus autour de la collection, le billet sur mon carnet sera mis à jour au fur et à mesure, mais si vous tenez à ne rien rater, je vous invite à suivre On ne compte pas pour du beurre sur Instagram !
En librairie
Émilie Chazerand & Clémence Sauvage, Autant de familles que d'étoiles dans le ciel, La Ville Brûle.
Sorti en avant-première pour le SLPJ (Salon du Livre et de la Presse Jeunesse), j’ai énormément vu cet album : coup de cœur des libraires, d’autres artistes auteurices, de tout le monde. Qu’en est-il ?
Dans notre essai sur les représentations LGBTQI+ en littérature jeunesse, Spencer et moi analysons les albums “panoramas de familles”. Il y en a une douzaine, relativement similaires, publiés entre 1999 et 2023. Il s’agit soit de récits centrés sur le questionnement d’un ou plusieurs personnages enfantins sur comment faire famille, soit de textes sur ce que seraient les familles, illustrés par différentes familles. Ces albums ont un objectif commun, inclure les familles “différentes” dans l’ensemble des structures familiales possibles, sans hiérarchie - objectif plus ou moins atteint selon les albums.
Bon, alors, est-ce qu’Emilie Chazerand a réussi à queeriser le genre ? Non.
Pour la première fois, on commence même l’album par une présentation de la famille normée. On nous dit, à propos d’une famille composée d’un papa, d’une maman, et d’un enfant (toustes blanc-hess) : “les familles sont généralement représentées ainsi”.
Priscille Croce en parle dans son livre sur les albums antisexistes, même si l’objectif est de remettre en question une norme, la présenter pour la remettre en question c’est participer à la (ré)instaurer. Pour un-e enfant qui a l’habitude de voir des structures familiales très différentes, cette dénonciation ne fera pas sens, comment ça les familles sont généralement représentées ainsi ? C’est pas vrai, dans la bibliothèque de la maison en tout cas ! Pour un-e enfant qui n’aura pas (encore) intégré ces normes, lui lire cet album c’est les lui présenter, peut-être pour la première fois. D’où l’intérêt, selon l’âge de l’enfant, son environnement, de privilégier des livres sans stéréotypes, plutôt que sur des stéréotypes, des livres avec des personnages marginalisés, plutôt que sur des personnages marginalisés.
Dans une interview, l’autrice explique qu’elle a voulu proposer un album qui manquait. Pourtant, le premier du genre a plus de 25 ans, et il en existe une quantité non négligeable - si vous vous demandez quelles sont les représentations qui manquent, on les a listées, les panoramas de famille n’en font pas partie.
Ce que fait cet album que les autres ne font pas, par contre, c’est mettre sur le même plan le fait de faire famille autrement1 (homoparentalités seulement en l’occurrence), et les “autres familles” (familles politiques, militantes, de collègues, de passionné-es, de victimes, etc.). La différence entre les familles faîtes autrement et les “autres familles”, c’est que les droits des fans de Star Wars ne sont pas constamment menacés et que personne ne milite pour que les médecins ne fréquentent pas leurs pairs. Oui, on peut avoir plusieurs “familles”, mais la norme cishétérosexuelle ne concerne que très peu les “autres familles” - certaines de ces familles ont même pour principale mission la protection de la norme cishétérosexuelle.
Pour une queerisation des panoramas de familles, on repassera...
Suzy Senior & Claire Powell (trad.), Qui embrasserait un crocodile ? Kimane.
Dans cette réécriture de La Belle au bois dormant, celle-ci est transformée en crocodile et sauvée par un duo de mamies : les Super-Mamies, reines du ménage. Là où les princes voulaient réveiller la princesse, réclamer le royaume et épouser la princesse, avant de s’enfuir face au crocodile, les mamies avaient pour programme nettoyer le château, soigner la blessure de la princesse et envoyer un bisous magique.
Une fois le royaume réveillé, on fait la fête, sans oublier d’inviter qui que ce soit cette fois.
Juliette Adam & Barbara Brun, Le jardin des lumières, Père Castor.
Naïm vit dans le jardin des lumières, lieu crée par ses parents. Au casting, nous avons l’amoureuse de sa sœur. C’est un non sujet, ce n’est pas la chute ou la révélation finale de l’album, il s’agit simplement d’amoureuses et c’est tout. L’amoureuse en question est noire, ce qui est encore trop rare - en littérature jeunesse, il est possible d’être lesbienne ou noire ou handicapée, mais jamais en même temps.
Annelise Heurtier & Virginie Costa, Les camions, Talents Hauts.
Un petit garçon est passionné par les camions. Son préféré, c’est celui… que conduit sa maman. Comme pour Bonjour pompier, l’album repose sur sa chute, une femme occupe un métier majoritairement masculin. Contrairement à un album où on dirait explicitement le caractère exceptionnelle d’une femme exerçant un métier majoritairement masculin, le stéréotype n’est pas présent dans l’album. Mais si la fin ne surprend pas, l’album fonctionne tout de suite moins bien, il ne s’agirait “que” d’une succession de camions.
Robert Tregoning & Pippa Curnick, La robe dans la vitrine, Gautier-Languereau.
Encore un petit garçon. Lorsque Léo aperçoit une robe qui brille dans une vitrine, il n’a plus qu’un souhait : l’enfiler pour danser. Sa maman lui dit de travailler pour la mériter, ce qu’il fait. Sauf que, catastrophe, la robe n’est plus là. Il rentre chez lui, et trouve tous les voisins et voisines qu’il a aidés, prêt-es à fêter son anniversaire. Que reçoit il comme cadeau ? “Une merveilleuse robe pou run merveilleux garçon”. Léo met la robe, sourit, se met à virevolter, à danser, suivi par toustes les invité-es. L’album se finit sur la maman et son fils :
Il sourit à sa maman et elle aussi sourit… à son fils, dans sa robe à lui, qui rayonne d’un amour infini.
Le fait que ce soit un garçon désirant une robe est un non sujet. Il y a un nombre important d’albums sur des garçons empêchés du fait de normes genrés, et ils peuvent être adaptés. Mais il est aussi important de montrer des petits garçons désirant virevolter dans des robes rouges à paillettes sans difficultés, notamment à des enfants qui n’auraient pas encore été empêchés.
A noter, quand Léo s’imagine qui a pu porter cette magnifique robe, il imagine un homme noir, une femme noire, une femme asiatique et une femme blanche. Il est possible pour tout le monde d’être magnifique dans une robe à paillettes rouges.
Linda Sunderland & Jessica Courtney-tickle (trad.), Le baiser, Kimane.
Dans cet album, une grand-mère garde précieusement le baiser de son petit-fils, matérialisé sous la forme d’une petite créature. Celui-ci est montré, partagé, volé, séquestré puis restitué. Les personnages sont non blancs sans être culturellement marqués (voir mon livre sur les personnages d’enfants non blancs en littérature jeunesse).
Jade Orlando & Stéphanie Taylor (trad.), Profession princesse : une histoire de femmes noires inspirantes, Kimane.
Depuis Histoires du soir pour filles rebelles, ce sont des dizaines de livres jeunesse sur des femmes extraordinaires qui ont inondé les rayons. Priscille en parle dans son guide, ces albums ont leurs limites :
Depuis 2017, on a vu une vague de portraits de femmes inonder les librairies. D’Auzou à Fleurus, toutes les maisons ont leur album ou leur documentaire sur des femmes libres, rebelles, grandes, fabuleuses, incroyables, extraordinaires, etc. Cette abondance cache un manque de représentations qui ne saurait être résolu par un livre montrant des femmes exceptionnelles. Chaque année, pour le 8 mars, on montre un titre sur des femmes qui ont révolutionné le monde, sans que les représentations genrées des catalogues s’améliorent.
Les femmes ont bien été invisibilisées dans tous les domaines, ce n’est pas une vue de l’esprit. Il est tout à fait légitime de mettre à l’honneur les femmes qui ont marqué l’Histoire. Mais les filles et les femmes méritent d’être les héroïnes de leurs histoires, quand bien même elles n’auraient pas de destins exceptionnels.
Qu’en est-il de notre princesse ? Une mère vient chercher sa fille à l’école, celle-ci lui dit qu’elle sera princesse plus grande. Sa maman lui présente des alternatives, avec à chaque fois un exemple de femme noire, comme elles : docteure comme Alexa Canady, danseuse comme Misty Copeland, athlète comme Alice Coachman, ingénieure spatiale comme Annie Easley, architecte, vétérinaire, autrice, etc. Mais la petite fille reste sur sa position : elle sera une princesse, comme la princesse Amina, la guerrière. Elle était forte, courageuse et intrépide, comme lui dit maman.
Ici nous n’avons pas “que” les portraits de femmes extraordinaires, mais le récit d’une inspiration, une maman a réussi à ce que sa fille puisse aspirer à la grandeur, puisse avoir des modèles lui ressemblant dans des professions valorisées. Il est important de valoriser les filles noires, de leur montrer différents modèles de femmes noires ayant accompli de belles choses. Mais laissons les être les héroïnes de leurs propres histoires, extraordinaires ou non.
Il se passe quoi ?
Les 12 et 13 février prochains se tiendra le colloque international «"Love is Blind" ? Amour, médias et cultures populaires de 1950 à aujourd'hui ».
Où m’écouter ?
Le 24 février, à la librairie Combo (Roubaix), à partir de 16h, pour une rencontre avec Chloé Vivarès (autrice de Papita) et moi-même autour d’On ne compte pas pour du beurre et de J’aimerais t’y voir.
Le 26 février, au Bonjour Madame (Paris), à partir de 19h, pour le lancement festif de la collection, en compagnie de (presque) toute l’équipe !
Le 29 février, au Monte-en-l’Air (Paris), à partir de 19h, autour d‘Où sont les albums jeunesse antisexistes ? avec Priscille Croce et moi-même, modéré par Laura Vallet (Fille d’album).
Le 6 mars, à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Caen), de 16h30 à 18h, dans le cadre de la semaine des féminismes organisée par Solidaires, Sud Education, Main Violette et Les Ateliers du genre.
On lit quoi ?
Il a quelques mois mais je l’avais raté, anamosa a publié un titre sur le terme “étranger” dans sa collection Le mot est faible.
On écoute quoi ?
Pour le Festival Hébé, Dialna a choisi de parler du "white female gaze" et des rapports de domination qu'il implique entre femmes blanches et femmes racisées avec Myriam Le Nahelec, membre de l’association Team.Sama, Pulandevii, artiste et analyste culturelle, et Fatima Khemilat, docteure en sociologie. La table ronde a été enregistrée et peut s’écouter ici.
Sur l’internet
Marronnier de toujours, qui, dans la chaîne du livre gagnerait le moins ? Cette fois-ci ce serait les éditeurs ! D’après une étude commandée par… le Syndicat national de l’édition (SNE). Cette étude porte uniquement sur les plus grosses structures et sur les secteurs les plus importants. Puisqu’il s’agit d’une étude sur “Le partage de la valeur entre auteurs et éditeurs”, on met de côté les 51% qui vont à la distribution, à la diffusion et aux libraires pour n’étudier que le CA net éditeur. On arrive alors aux nombres qui ont circulé : les éditeurices ne conserveraient “que” 17,8% du CA net éditeur, alors que les auteurices en percevraient 24,8%. Comment arrive-t-on à ces chiffres ? En retirant l’ensemble des coûts (fabrication, salaires, frais marketing et promotion, coûts de stockage et de logistique) au CA net éditeur. Sauf que les auteurices ont elleux-mêmes des coûts et ne conserveront pas l’entièreté des sommes perçues. Il ne s’agit donc pas de pourcentages comparables.
On a aussi parlé fact-checking dans l’édition, traductions littéraires vs IA et publics des boîtes à livres.
Titre de l’essai de Gabrielle Richard sur les familles queers.